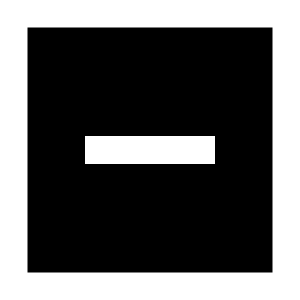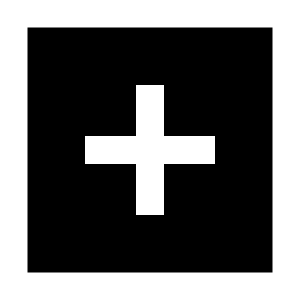Gilles CLAVREUL - 29 Mar 2021
Identités et systèmes de valeurs
Réunions en non-mixité : ne pas justifier l’injustifiable
← RETOUR AUX NOTESGilles CLAVREUL - 29 Mar 2021
Réunions en non-mixité : ne pas justifier l’injustifiable
Réunions en « non mixité » : ne pas justifier l’injustifiable Dans un court essai paru l’an dernier, Laurent Bouvet alertait sur Le péril identitaire (L'Observatoire). Ce nouvel âge, où les dynamiques collectives s’éloignent de la conflictualité sociale et des affiliations politiques pour se porter sur des identifications de genre, de religion, d’orientation sexuelle ou encore de « race », nous en avons désormais presque quotidiennement la manifestation, presque toujours polémique et éruptive. Dans cette affaire, Laurent joua le rôle ingrat de Cassandre, annonçant – non pour s’en réjouir, mais au contraire pour s’en inquiéter – que l’air du temps nous amènerait de nouveaux types de clivages auxquels notre nation laïque et universaliste, pourtant prodigue de conflits en tout genre, était peu habituée. La réapparition du mot « race » dans l’espace intellectuel et militant, depuis une quinzaine d’années, aurait dû être à elle seule une alerte pour tous les démocrates. Aujourd’hui, ce terme venu de la plus extrême extrême-droite est légitimé et porté en majesté par des universitaires, des médias, des militants, semant le trouble jusque parmi les esprits les plus lucides. Le tout dernier épisode en date, sur les réunions dites « non-mixtes », illustre les données essentielles du problème – et laisse malheureusement peu d’espoir que celui-ci se résolve rapidement, et que les polémiques s’apaisent. Confusions en série Notons d’abord le degré extrême de confusion des débats. Ce qui pose question depuis quelques années, ce sont des regroupements militants de personnes identifiées par leur « race », leur orientation sexuelle ou leur genre, à l’exclusion de personnes issues de groupes définis comme dominants et oppresseurs : les « blancs » pour les « non-blancs », les « hommes cis » et certaines féministes pour les lesbiennes et les trans, les hommes pour les femmes. Il suffit d’écrire les choses aussi simplement pour faire ressentir une première différence, et elle est de taille : dans le dernier cas, celui de la différence de genre, je peux exprimer la distinction dans un langage clair et compréhensible par tous : hommes, femmes, on est dans des critères (encore) simples et reconnus. Certes, il arrive désormais qu’on se revendique « non binaire » et ainsi de refuser d’être affilié à son genre biologique ; d’autres réclament qu’on remplace le mot « femme » par « personne qui menstrue », une personne trans pouvant se sentir offensée d’être exclue de l’identité de genre à laquelle elle s’apparente même si elle n’a pas le corps biologique d’une femme ; mais on a identifié pour ces formes particulières de victimité des catégories elles-mêmes particulières : ainsi une personne trans sera dite victime de transphobie, et pas de machisme. S’agissant justement des personnes LGBT+, de nouvelles désignations ayant été créées pour désigner des féministes transphobes (« TERF », pour «trans exclusionary radical feminist »…le langage militant a ses obscurités) et des hommes gays dits « cisgenre », susceptibles de lesbophobie et de transphobie. Pour la « race », le problème est encore bien plus complexe : « blancs », « noirs » ou plutôt « afro-descendants », « racisés », selon le participe passé générique qui a la faveur des chercheurs et militants « décoloniaux », il me faut recourir à des catégories dont la définition est à la fois ésotérique et incertaine. On y reviendra. Ces réunions ne sont pas n’importe quel rassemblement affinitaire, contrairement à ce qu’une lecture relativiste – et surtout confusionniste - laisse croire. Que les groupes sociaux tendent à se définir par des critères qui leur sont propres, quitte à « fermer la porte derrière eux », n’a rien de nouveau : c’est le cœur de l’analyse sociologique que d’expliquer de telles logiques. Elles ne sont pas forcément délétères par elles-mêmes : le principe même de la liberté d’association est de se regrouper par affinités, sans avoir à respecter d’autres restrictions que celles posées par la loi. Reste que, dans tous ces cas, l’homogénéité existe de facto : elle est très rarement une règle (il y a des exceptions, comme ces clubs masculins qui, à l’image de l’Automobile Club de France, sont une survivance, la relique d’un temps révolu), et dans l’immense majorité des cas elle est la résultante des relations sociales et des affinités culturelles (langue, origine, pratique religieuse, etc.) qui unissent ses membres. Les rassemblements non-mixtes nous disent tout autre chose : l’homogénéité n’y est ni incidente, ni accessoire ; elle est leur objet même et leur raison d’être. L’entre soi n’est pas la résultante de la pratique, il est la pratique elle-même. Et pour cause : ils sont essentiellement – et leurs instigateurs y tiennent – des initiatives politiques. Ce qui les distingue, non seulement des associations classiques, mais également des groupes de paroles à vocation thérapeutique, ou destinés à protéger les victimes et à leur permettre de s’exprimer sans crainte. On approche du cœur du problème. D’abord, la comparaison, que font certains, avec les « Alcooliques anonymes », est plus que saugrenue : l’alcoolisme est une maladie, faut-il le rappeler ? Etre noir, femme ou gay, en revanche, n’en est pas une ! Et la personne sobre n’est pas à l’alcoolique ce que le raciste est à l’antiraciste ou le prédateur sexuel à la femme harcelée. Ensuite, et plus largement, il ne faut pas confondre le besoin que des victimes éprouvent de partager entre elles une expérience traumatique ineffable – guerre, attentat, catastrophe naturelle ou violence routière, pour prendre volontairement des exemples situés hors du débat actuel -, avec la systématisation militante qui transforme une simple faculté en une revendication. On sait par ailleurs que les mêmes victimes ressentent également et peut-être d’abord le besoin d’être écoutées par les non-victimes, et que leur trauma soit reconnu et leur souffrance authentifiée par ceux qui, précisément, ne l’ont pas vécue. On se rappelle la hantise de Primo Levi : ne pas être cru par ceux qui n’ont pas connu les camps. Se parler entre victimes, certes ; mais se fermer délibérément à des tiers, c’est tout autre chose. Confusion là encore. L’analogie avec les luttes féministes ne tient pas Une autre justification est proposée, celle du pragmatisme : se réunir en « non-mixité » est un outil, et rien de plus. Dans cette optique, il s’agirait uniquement de rechercher l’effet utile en permettant ponctuellement à des personnes partageant une souffrance commune d’échanger leurs points de vue, de confronter leurs expériences et de discuter librement de moyens d’action propres à contrer les discriminations dont elles sont victimes. A défaut de pouvoir être justifié sur le plan des principes, les réunions non mixtes auraient une efficacité pratique, éprouvée, notamment, par les féministes du MLF, pionnières de ce genre de réunions. Cet argument est certes plus solide : d’abord parce qu’en effet, personne n’est mieux placé que les premières concernées pour constater les effets positifs des expériences collectives mises en place ; ensuite parce que ces pratiques, même si on a pu les considérer excessives – et parfois elles l’ont été, teintées d’un discours misandre qu’on n’est vraiment pas obligé, rétrospectivement, d’approuver… - n’ont jamais débouché sur des appels à la violence. L’histoire du féminisme, même dans ses expressions radicales, plaiderait donc sinon pour encourager la non-mixité, du moins pour la tolérer à titre d’expérience militante. Pour autant, faut-il considérer que les luttes féministes ont abouti « grâce » à ce type de dispositifs, et plus largement grâce aux formulations les plus radicales du féminisme, ou qu’au contraire elles ont réussi en dépit d’elles ? La question n’est pas facile à trancher…Du reste, les féministes historiques l’admettent volontiers, ces réunions n’ont pas duré ; c’est-à-dire qu’elles ne les défendent que mollement, contrairement aux militants décoloniaux et intersectionnels d’aujourd’hui, qui n’envisagent pas de terme à ces pratiques non mixtes. Dernier argument, que personne n’invoque mais qui aurait pourtant du poids : les réunions de femmes sont déjà autorisées par la loi, précisément lorsqu’elles ont pour effet ou pour objet de réunir des victimes de violences machistes, ou bien de promouvoir les droits des femmes. Cela fait partie des cas d’exception au principe de non-discrimination prévus à l’article 225-3 du code pénal. On n’entrera pas ici dans le détail d’un débat juridique complexe. Bornons-nous à constater que ces exceptions, qui découlent directement du droit européen, semblent tout à fait légitimes ; d’autres en revanche, comme l’autorisation des clubs unisexes, au nom de la liberté d’association, interrogent davantage : dans un cas, il s’agit de favoriser les féministes, dans l’autre de ménager les sexistes ! Mais retenons l’idée essentielle : la discrimination est réprimée en principe et, par exception, des différences de traitement peuvent être acceptées pour peu qu’elles répondent à un but légitime et utilisent des moyens en rapport avec la poursuite de ce but. Voilà ce que dit notre droit, celui de tous les Européens. Alors, si exception il y a, il va de soi qu’elle doit être incontestable. Deux conditions semblent alors nécessaires : lutter contre une discrimination (sexiste, raciste, homophobe, etc.) et favoriser la prise de parole des victimes. Premier problème, dans le cas des rassemblements non mixtes : ils s’adressent non à des victimes, mais aux membres d’un groupe identifié, globalement, comme victime. C’est l’identité collective qui fait la condition de victime, non le fait d’avoir réellement subi une agression. L’expression « réunion entre concerné.e.s » permet de maintenir l’ambiguïté entre victime potentielle et victime réelle, et entre l’individu et le groupe. A supposer même qu’on valide cette idée, contestable, de victimité virtuelle, encore faut-il rappeler que, la où les femmes ne peuvent être que victimes du machisme et non pas auteurs (la violence d’une femme envers une autre femme peut recevoir bien des noms, mais pas celui de machisme), on peut très bien à la fois appartenir à un groupe « racisé », et être raciste soi-même. De ce fait, alors qu’une réunion féministe non mixte ne peut accueillir de machistes, une réunion « racisée » est fermée à un antiraciste blanc, mais ouverte à un suprémaciste noir. Curieux atelier de lutte contre le racisme… Deuxième problème : ces réunions ne sont pas seulement, comme on l’a dit, des groupes de paroles ou des ateliers, mais des rassemblements militants, par exemple un carré « racisé » au sein d’une manifestation, ou un événement se déroulant sur une journée entière. L’objet n’est donc plus d’éviter que des « agresseurs potentiels » (puisqu’il y a des victimes potentielles…) viennent perturber la prise de parole : il s’agit bien d’exclure certaines catégories de personnes d’un rassemblement public, sans crainte particulière ni motif valable prévu par la loi. Là, on entre bien dans le champ de la discrimination au sens pénal. On comprend mieux pourquoi les décoloniaux et autres militants intersectionnels, d’ordinaire si procéduriers, n’entrent pas volontiers sur le terrain juridique. Introuvables « races » A partir de là, on peut s’attendre à une dernière objection : et alors ? Si la loi autorise les rassemblements entre femmes et interdit les réunions entre « racisés », c’est donc que la loi est mal faite ! Alors changeons la loi ! En effet, pourquoi pas ? Surgit le troisième problème : mettre sur le même plan réunions féministes, réunions LGBT+ et réunions « racisées » n’a pas de sens. Non pas, bien entendu, parce que ces différents groupes ne subiraient pas le même type ni le même niveau de violence ou de discrimination : racisme, sexisme ou homophobie, toutes les discriminations se valent, et la loi les réprime toutes de la même manière. En revanche, il y a une différence irrécusable : c’est qu’autant on sait à peu près dire ce qu’est un homme et ce qu’est une femme, autant il n’existe aucune définition solide – et pour cause – de ce qu’est un « blanc » et de ce qu’est un « racisé » ou un « non-blanc » puisque tels sont les critères, totalement subjectifs et arbitraires, qui déterminent qui a vocation à participer à ces réunions, et qui n’a pas le droit d’en faire partie. Exemples simples : les Juifs, les Tsiganes, sont-ils « blancs », et donc interdits de réunion ? Il semble pourtant difficile d’ignorer qu’ils sont en proie au racisme ! Un Français d’origine espagnole ou sud-américaine ? Il sera sans doute identifié comme blanc, mais pas forcément aux Etats-Unis où, parmi les « Latinx », comme on les appelle désormais, certains se considérent comme « blancs » et d’autres non. A l’inverse, un Maghrébin sera invariablement catégorisé « racisé » en France ; aux Etats-Unis, si l’on s’en réfère au National Census, il est blanc. En d’autres termes, ce qui invalide à coup sûr ces réunions non mixtes « racisées », c’est tout simplement que la « race » est une notion totalement arbitraire, que la définition des groupes varie dans le temps et d'un pays à l'autre en fonction des stéréotypes communs et du travail militant exercé au sein des minorités. Or, il n’y a aucune raison pour que quiconque, militant ou scientifique, s’arroge le droit de définir les contours de quelque groupe « racial » que ce soit. C’est d’ailleurs en raison de ce caractère flou et arbitraire que le Conseil Constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelles les statistiques fondées sur la « race » et « l’ethnie ». Le droit, là encore, fixe des bornes raisonnables à l’expression désordonnée et virulente de revendications qui se prétendent des droits, et qui n’en sont pas. En vérité, il ne s’agit plus seulement de pratique discriminatoire, mais bel et bien de racisme, au sens le plus fort de l’expression. Voilà pourquoi il n’est pas possible de mettre sur le même plan réunions féministes et réunions « racisées » : dans un cas, il y a une pratique thérapeutique ou militante, réunissant des membres d’un groupe aux caractéristiques objectivables, les femmes ; dans l’autre, un rassemblement politique qui exclut un ou des groupes sur un critère purement arbitraire, celui de la couleur de peau. L’un est autorisé par la loi, l’autre est réprimé. Ce n’est pas plus compliqué que cela, et c’est pour cela qu’en aucun cas on ne peut accepter, fût-ce au titre d’un bénéfice pour les intéressés qui reste à démontrer, ces réunions en non-mixité « racisée ». * * * L’embrasement politico-médiatique autour de ces réunions non mixtes confirme l’omniprésence pesante de ces querelles identitaires, qui rendent l’air démocratique difficilement respirable. La non-mixité « racisée » ne soigne rien, au contraire, elle avive les plaies ; elle ne rassemble pas, elle enferme. Elle ne réunit pas, elle divise. Toute autre est la proposition républicaine, dont les décoloniaux et autres partisans d’une alternative différentialiste se plaisent à faire le procès. Alors que la logique identitaire dit : « on se rassemble parce qu’on se ressemble », l’universalisme républicain dit à peu près l’inverse : ce qui fait qu’on se ressemble (un peu), c’est notre volonté commune de nous rassembler, de bâtir un projet collectif, de s’inventer un destin commun. Pas besoin de délaisser ses attaches particulières, d’abandonner sa foi, de renier sa culture : il suffit juste de tracer un cercle imaginaire dans l’espace public, où tous les citoyens, sans exclusive ni distinction, sont conviés à délibérer. Certes, cela ne marche pas tout seul, par la seule grâce de la proclamation des principes : la République implique un travail politique pour instituer le commun. C’est de cela que nous manquons aujourd’hui, et non de « safe spaces » où l’on se protège de la rencontre avec l’Autre.