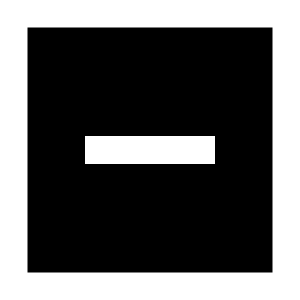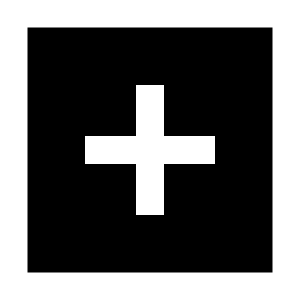Didier LESCHI - 29 Juin 2018
Identités et systèmes de valeurs
D’excellents Français : les « collabeurs » de la République
← RETOUR AUX NOTESDidier LESCHI - 29 Juin 2018
D’excellents Français : les « collabeurs » de la République
Qu’est-ce qu’être musulman quand on fait face aux dérives à la fois de l’entre soi communautariste qui peut amener au djihadisme et à l’injonction intégratrice. Musulman croyant ? Musulman « sociologique » ? Comment se situer en termes d’identité ? Tous les livres dont nous rendons compte ici – et dont il faudrait, pour être plus précis, souligner qu’il proviennent de personnes issues de familles maghrébines interrogeant, le plus souvent à travers leur réussite, mais quelque fois leur échec, leur rapport à la société française et à l’islam – soulignent la difficulté du positionnement individuel et surtout de la difficulté du rapport à la foi et au culte que l’on essaye de mettre d’autant plus à distance que l’image que donnent les extrêmes de l’islam semblent devoir obliger les auteurs à affirmer une prise de distance même quand ils sont croyants.Prendre position comme « musulman »
C’est clairement le cas d’Amine El Khatmi qui en introduction de son cri d’alarme s’affirme « musulman pratiquant », mais qui, face « à la bonne conscience de gauche », dont il a le sentiment qu’elle refuse de voir les dérives à l’œuvre ou se tait devant elles, veut exprimer plus que son inquiétude. Il est vrai que la révolte d’écriture d’El Khatmi a été aiguillonnée par une émission de télévision qui n’est pas à l’honneur du journalisme et de personnalités de gauche et où était invitée, comme une « madame tout le monde » devant raconter ses difficultés du quotidien face au racisme, une militante du racisme indigéniste et antisémite du parti des Indigènes de la République.
Face à cette militante qui, avec ses pairs, fait de la victimisation une sorte de commerce indécent, accusant la France d’être avant tout un pays raciste contre lequel la radicalité de l’islamisme est une forme de résistance légitime, il est à l’honneur de cet élu de terrain de souligner l’urgence de résister. Il est sans doute celui qui, parmi tous ces auteurs est le plus tranchant, d’abord vis-à-vis de ses camarades de parti dont il souligne la difficulté à le soutenir alors qu’il est en première ligne, traité de « collabeur », victime d’une chasse aux sorcières.
C’est d’abord du côté de ces élus des villes, dont les communautés ouvrières issues de l’immigration ont été particulièrement touchées par la crise industrielle, que l’on trouve les propos les plus documentés sur la montée de « l’islamisation des quartiers », selon la formule qu’ils utilisent. Naïma M’Faddel décrit parfaitement la manière dont cette crise sociale a accentué l’entre soi de la pauvreté communautaire, un « fonctionnement en vase clos ». Elle souligne, dans son dialogue avec Olivier Roy – qui comme elle, habite à Dreux –, les impasses d’une politique de la ville qui n’a pas su organiser la mobilité sociale, partant du principe qu’il fallait mieux organiser un traitement social des difficultés par de la proximité culturelle et géographique, plutôt que d’inciter à la mobilité.
Bien sûr, est évoqué l’appel aux « grands frères », qui a été un moment de la politique de la ville. Mais surtout, son dialogue avec le spécialiste de l’islam politique lui permet de mettre en exergue l’impact culturel des sociétés d’origine dans les logiques d’enfermement. Sa dénonciation des mariages dit hallal, comme forme de légitimation de la polygamie dont sont d’abord victimes des femmes en situation de précarité sociale et juridique, est à ce titre assez exemplaire de ce que peut être une pression religieuse sur la vie individuelle avec le soutien d’imams qui, sans être djihadistes, n’en sont pas moins des ennemis des principes d’égalité entre homme et femme.
Un document de première main
Cette conjonction entre difficultés sociales et pressions que des littéralistes font peser sur des personnes ou familles d’origine maghrébine, pour qu’elles adoptent des comportements qui seraient ainsi plus conformes à la bonne croyance, est aussi au cœur du témoignage d’Henda Ayari. Elle y décrit de manière brute, dans un dévoilement particulièrement courageux, comment une jeune femme peut basculer du mauvais côté de la vie sous la pression à la fois d’un milieu familial dominé par le conservatisme religieux et du charme d’un homme qui semble d’autant plus pur dans ses sentiments qu’il se présente comme étant d’une très grande croyance.
Croyance sans profondeur pourtant, maniant la peur du diable comme argument sans appel pour entrainer cette jeune femme dans une logique d’enfermement au sein de laquelle elle admet avoir trouvé, au moins dans un premier temps, une sorte de sécurité face à l’adversité du monde et au deuil. Elle décrit ainsi une logique d’emprise sectaire propre au salafisme, qui fonctionne particulièrement quand elle vise des personnes en difficulté psychologique. Jusqu’au moment où le prince charmant devient une sorte de bourreau qui vit au crochet de sa victime, victime qu’il a lesté d’enfants utilisés comme objets de chantage, et à qui il finit par imposer sa volonté de « faire la polygamie, comme on fait le bien et le mal ». Et la polygamie dans le discours salafiste, c’est halal, comme le mariage du même nom, aux yeux de Dieu … Henda Ayari s’en est sortie et décrit son expérience comme « un long chemin du salafisme à l’humanisme ». A ce titre, il s’agit d’un document de première main.
Comme Henda Ayari, Sonia Mabrouk est d’origine Tunisienne. A travers ces deux témoignages se mesurent les tensions propres à la société tunisienne en fonction des milieux sociaux et culturels et leurs répercussions sur les dynamiques d’intégration, ici en France. Sonia Mabrouk organise son propos autour d’un dialogue avec sa grand-mère, particulièrement vive d’esprit, admiratrice de Bourguiba. La politique de laïcisation forcée, propre à ce « despote éclairé », a fait en sorte, dit-elle à sa petite fille, « qu’elle n’a jamais porté le voile ». Elle affirme du reste ne pas « avoir besoin du voile pour se sentir musulmane ».
A travers sa grand-mère s’exprime une nostalgie d’une France rêvée, telle qu’elle peut encore s’exprimer chez des personnes d’un certain âge qui regarde de l’étranger l’évolution de notre pays comparé au leur. La grand-mère de Sonia Mabrouk lit les Mémoires de guerre du Général de Gaulle et proclame à sa petite-fille, incitée par son métier de journaliste à bien plus souligner ce qui ne va pas que ce qui va bien, que « la France n’est pas n’importe quel pays dans le monde ». A travers ce livre, où pointe l’admiration pour la France – c’est du reste une constante pour tous ces auteurs – apparaît en creux la perte de grands desseins qui puissent encore mobiliser notre pays. Une manière de rappeler que pour celui qui veut s’intégrer, il faut qu’il soit accueilli par un pays qui lui permette d’être fier de le rejoindre ou d’y être né. Certes il ne s’agit pas de cacher ce qui ne correspond pas aux promesses affichées dans la devise républicaine, mais par comparaison d’en souligner les aspects positifs, comme la laïcité. La grand-mère de Sonia Mabrouk donne une leçon d’attachement à la France qui, comme l’avait ressenti Régis Debray lors de ses expériences latino-américaines, se manifeste d’autant plus quand on la regarde de loin.
Et c’est à travers son récit particulièrement bien tourné, le plus profond et le plus foisonnant, grâce à ce dispositif du dialogue intergénérationnel, que Sonia Mabrouk aborde la violence du racisme en Tunisie à l’égard des noirs de toutes origines. Racisme structurel et permanent qui remonte aux pratiques d’esclavage dont cette région du monde a été aussi, malheureusement, un des hauts lieux, comme vient de le rappeler tragiquement le renouveau de marchés aux esclaves en Lybie.
S’intégrer, c’est être accueilli par un pays qui permette d’être fier de le rejoindre
Fatma Bouvet de la Maisonneuve, forte de sa réussite sociale comme médecin et comme élue locale, s’exerce aussi au regard croisé. Elle aussi est originaire de Tunisie et d’une famille aux fortes ressources culturelles. Son exercice de comparaison lui permet de souligner, bien sûr les écarts, mais aussi les points de contact et les rejeux de l’histoire. Ainsi, ce passage sur l’explication des grands événements par les théories du complot qui existent des deux côtés de la Méditerranée.
De la même manière que, de la Révolution française aux années trente, les remises en cause de l’ordre politique des choses et les moments révolutionnaires ont été expliquées par des courants réactionnaires comme le produit de complots « judéo-maçonniques », de même la révolution tunisienne a vu émerger ce type d’explication. En dénonçant ces discours auxquels elle a été confrontée, elle rend, elle aussi, hommage à un aïeul qui était « syndicaliste et Vénérable de la loge Emir Abdelkader de Tunis et arrivé au trente-troisième degré du Grand Orient de France, soit le plus haut grade ». Cette loge fut dissoute après l’indépendance. Résistant à Vichy et amoureux de la France, il faisait partie de ces passeurs de l’esprit des Lumières qui luttèrent dans le Maghreb colonial contre un antisémitisme qui irriguait dans les possessions françaises à partir de la métropole.
La disparition des générations qui ont fait les batailles d’indépendance souligne et accélère les involutions de ces sociétés, justement parce qu’elles voulaient prendre la France au mot de ses valeurs. Mais elles n’ont sans doute pas réussi à maintenir l’idéal de liberté et de savoir qui avait été à l’origine de leur combat. Comme en France, l’antisémitisme est un bon curseur du mauvais état des pays du Maghreb. Mabrouk, comme Bouvet de la Maisonneuve, le souligne. Cette dernière y ajoute le « racisme anti nous-mêmes ». Il s’agit de ce comportement post-colonial qui fait que, depuis l’aéroport, jusqu’aux piscines des hôtels auxquelles les personnes d’origine tunisienne n’ont pas accès, jusqu’aux pissotières, à l’exception de celle des mosquées, un occidental « blond » (comme son mari) est toujours mieux traité que le tunisien …
Quelle identité ?
Mais au bout de ces lectures, il apparait bien que la plus grande des difficultés pour tous ces auteurs est de se situer par rapport à la mosquée, et donc à l’identité musulmane. Le récit de Magyd Cherfi permet de mesurer ce qu’a eu comme conséquence l’échec de la « marche des beurs » pour l’égalité en 1983. Des promesses non tenues débute l’effondrement des identités laïques au profit d’une réaffirmation d’une identité musulmane. Magyd Cherfi décrit un monde qui n’est plus, celui des « rebeus », pour lesquels la question musulmane était très secondaire.
En ce sens, la littérature permet de mieux saisir ce qui n’est plus. L’auteur, ancien parolier du groupe toulousain Zebda, et qui n’en est pas à son premier livre, le fait avec talent. « Un rebeu qui joue Créon », voilà qui situe les questions autour de l’école sur un autre plan que le port du voile. La « part de Gaulois » affirmée dans le livre se situe justement dans un ailleurs qui semble oublié, comparé à la recherche par les autres auteurs de leur part de « musulman ».
Musulman sociologique ou musulman croyant ? Tous les autres livres demeurent entre les deux pôles de cette équation et ainsi dans la roue du nom musulman. Surgissent alors les difficultés. Même si l’affirmation d’une identité musulmane sociologique s’accompagne de la volonté de mettre à distance la croyance elle-même, elle n’arrive pas à s’émanciper du marquage religieux ou communautaire. M’Faddel regrette ainsi que les musulmans sociologiques ne soient pas représentés par le conseil français du culte musulman. Pourtant si un tel musulman ne souhaite pas s’identifier comme croyant, quel serait l’intérêt ?
S’exprime ainsi, sans penser à mal, son souhait d’une représentation communautaire qui va pourtant à l’encontre de l’idée de la République qu’elle défend par ailleurs. Il s’agirait à travers cette représentation sociologique de mettre en place un groupe de pression dont on voit mal comment il s’articule avec son idée de laïcité et son refus du communautarisme. D’autant que, dans le même temps, ces auteurs affichent une volonté de ne pas se mêler de la gestion du culte. C’est le cas d’El Khatmi qui souhaite que l’exercice public du culte, à la base de notre droit, évolue vers un exercice privé, en dehors de l’espace public. D’où ses critiques peu amènes vis-à-vis de l’Observatoire de la laïcité.
Mais ce faisant, alors même qu’il s’affiche comme croyant, la question qui est au cœur de la lutte contre l’islamisme n’est pas abordée. Comment faire en sorte qu’émerge une théologie de l’altérité à partir de la croyance musulmane ? Sonia Mabrouk est dans la même impasse. Certes, elle rappelle que le Coran n’est pas que violence et qu’il recèle des milliers de versets « prônant la bonté et la concorde », mais sa disqualification du conseil français du culte musulman ne s’accompagne d’aucune proposition pour faire en sorte que les croyants musulmans soient représentés à la « table de la République » selon la formule de Jean-Pierre Chevènement, comme le sont les croyants des autres cultes.
Nous touchons ici la difficulté de cette construction identitaire qui se veut laïque tout en se disant musulmane. Ces témoignages sont d’un apport fondamental ; ils sont aussi les marques d’un tâtonnement salutaire sur le chemin d’une construction identitaire pour « faire d’excellents Français ». Mais de même qu’être Français n’oblige plus à passer, depuis la Révolution, par l’affirmation d’une identité catholique, être français d’origine immigrée ne devrait plus passer par l’affirmation d’une identité musulmane, quel qu’en soit le contenu.
Auteur : Didier LESCHI, préfet, directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) Dernier ouvrage paru, Misères de l’islam de France, Le Cerf, 2017. Mots-clés : intégration, identité, citoyenneté