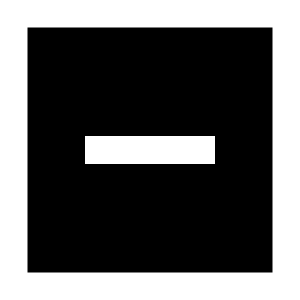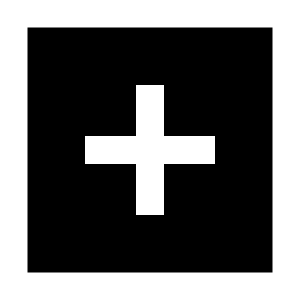Renée FREGOSI - 12 Sep 2018
Démocrature
- Les dictatures face à la démocratie
Car comme l’a bien souligné Hermann Kantorowicz dès 1935 (« Dictatorships », Revue Politica, Cambridge 1935), à rebours de la majorité des analystes de l’époque, la dictature contemporaine est un autoritarisme « moderne » et non pas le produit d’un quelconque archaïsme politique ou d’une arriération économique. Selon lui, d’une part, « la plupart des méthodes dictatoriales ont été rendues possibles par notre civilisation mécanisée, qui met tous les progrès de la communication, des transports et de la publicité à la disposition des dictateurs, et pour cela, nos nations hautement civilisées sont loin d’être à l’abri des dictatures ». D’autre part, c’est précisément parce qu’elles appartiennent au monde moderne que les dictatures doivent lutter contre les traces et habitudes de la démocratie mais qu’elles sont aussi prises dans une logique telle qu’elles doivent se justifier de suspendre la démocratie et tendront à affirmer qu’elles procèdent de la volonté populaire.
Certaines périodes du XXe siècle ont ainsi été prolixes en dictatures à travers le monde. Dans les années 1930 d’abord, une vague de régimes autoritaires s’abat en Europe et en Amérique latine pour la première fois depuis la fin des régimes monarchiques européens et des républiques oligarchiques latino-américaines. Coups d’États militaires ou coups de force politiques se multiplient. Ces dictatures des années 1930 s’opposent de façon explicite à la démocratie parlementaire qualifiée volontiers de démocratie de façade par les idéologies bolcheviques et fascistes.
Après la Seconde Guerre Mondiale, dans les années 1970 les dictatures se sont à nouveau multipliées notamment en Turquie, au Moyen Orient (Syrie, Irak), en Asie (Pakistan, Indonésie) et en Amérique latine. Apparaît alors un nouveau type de dictature : les régimes « bureaucratico-militaires » (selon la typologie de Juan Linz, Régimes totalitaires et autoritaires. Ed. Armand Colin, Paris 2006) ou régime de juntes militaires qui à la suite d’un coup d’État se présentent comme les meilleurs garants des institutions démocratiques menacées par le communisme. Ces régimes militaires sont qualifiés de bureaucratiques parce qu’ils s’implantent dans des États qui possèdent des administrations publiques diversifiées modernes et vont d’ailleurs fonctionner sur le mode de gouvernement de facto civilo-militaire, où certes les militaires dominent mais où des civils jouent un rôle important, notamment dans la police, l’éducation et l’économie.
La démocratie constitue donc une référence incontournable avec laquelle les dictatures, autoritarismes modernes, doivent composer. Les justifications de la suspension des institutions démocratiques sont essentiellement de deux ordres : dans les années 1930 aussi bien dans la version fasciste que communiste, la démocratie parlementaire est considérée comme une tromperie du peuple ; dans la période de la guerre froide, la nature dictatoriale du bloc communiste permit paradoxalement la complaisance voire le recours assumé à la forme dictatoriale dans le reste du monde pour prétendument empêcher la propagation du modèle et de l’influence bolcheviques. On parlait alors volontiers de « régimes forts », euphémisme pour désigner notamment les dictatures bureaucratico-militaires qui mettaient un frein aux demandes sociales considérées comme « excessives » (voir Samuel Huntington, Michel Crozier, Joji Watanuki, The crisis of Democracy. Ed.NYPU 1975).
Mais, dans les années 1980 déferla sur le monde, la « troisième vague de démocratisation » (selon l’expression de Samuel Huntington, The third Wave. Ed.Univ.Oklahoma Press 1993). Et après la chute du Mur de Berlin, la démocratie semblait vouloir s’imposer partout tandis qu’elle devenait le référentiel dominant à l’échelle mondiale. Depuis les années 1990, il est difficile en effet de se justifier sur la scène internationale si on n’acquiesce pas à cette grande valeur inscrite au fronton de l’ONU. Après le Consensus de Washington[1] et les préceptes de la « bonne gouvernance », la démocratie politique devient une condition sine qua non des aides internationales et de la reconnaissance de la communauté internationale. À partir des années 1990, l’acte électoral est alors l’enjeu de différents acteurs et l’objet de toutes les attentions, et de tous les détournements aussi. Avec la sortie de la guerre froide, l’élection libre devient l’axe de la définition de la démocratie.
Les dictatures sont donc des régimes modernes dans le sens où ils se situent dans l’horizon démocratique constituant la modernité. Challengers de la démocratie, les dictatures proposent un autre modèle politique, soit radicalement opposé à la démocratie, soit prétendant en mettre en œuvre une version plus efficace, plus stable voire plus accomplie. Ce sont ces régimes, tous régis par un principe autoritaire de l’imposition mais confrontés explicitement au principe démocratique du libre choix, que l’on peut désigner comme des dictatures au sens strict, par opposition aux autoritarismes de l’ancien régime. Mais, lorsque la prégnance de l’idée démocratique est très forte, lorsque le référentiel démocratique est dominant ou que son hégémonie résiste aux assauts des idéologies anti-démocratiques, les dictatures vont avoir tendance à se présenter comme commissariales alors même qu’elles tentent d’instaurer un nouveau modèle politique et de société. Il va donc être d’autant plus important de savoir distinguer dictature et démocratie.
- Une dictature « post-moderne »
Ce n’est donc qu’à partir des années 1990 et plus encore avec le XXIe siècle, qu’une autre forme de dictature (déjà existante mais peu fréquente jusque là si ce n’est au Paraguay de Stroessner, qui se fera réélire 7 fois entre 1954 et 1989), plus perverse encore, va se répandre : la « démocrature ». Le terme de « démocrature » est popularisé en français par Max Liniger-Goumaz dans son ouvrage La démocrature : Dictature camouflée, démocratie truquée (L'Harmattan, 1992). C’est la traduction littérale d’un néologisme inventé par les théoriciens des transitions à la démocratie dans les années 1980 (on en trouve la définition au volume 4 de leur ouvrage canonique sous la direction de Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter, et Laurence Whitehead : Transition from Autoritarian Rule, Ed. Johns Hopkins U.P., Baltimore 1986, Transiciones desde un gobierno autoritario,Tome 4, Ed. Paidos, Buenos-Aires 1988). La democradura, est un mot valise accolant « democra » de democracia et « dura » de dictadura, qui signifie aussi « dure » (évoquant la dureté de la répression en dictature), ce second jeu de mots étant perdu dans la version française avec la désinence « ture » de dictature.
Contrairement à ce qui circule sur internet et dans certains ouvrages peu rigoureux (notamment Jérôme Baschet, Adios al capitalismo, Ed. Jajo del volcán, Madrid 2015) ce n’est pas Eduardo Galeano qui a inventé ce terme. En revanche, Galeano en a retourné le sens : pour lui, la démocratie « bourgeoise », la démocratie politique et ses élections, serait une fausse démocratie, en fait une dictature de classe et donc une democradura. (Nosotros decimos no: Crónicas (1963/1988) Ed. Siglo XXI, Madrid 1989). La démocrature cristalise en effet à son tour, toutes les confusions auxquelles peut donner lieu la polysémie du mot démocratie. Ce que Galeano nome democradura c’est la démocratie dite libérale, la seule démocratie existante aujourd’hui, avec tous ses défauts certes mais avec le mérite d’exister.
La définition de la démocrature donnée par ses véritables promoteurs politologues est en fait la suivante : une dictature déguisée en démocratie par l’organisation d’élections non libres, contrôlées et/ou frauduleuses. Cette figure politique d’un régime qui joue à la démocratie en se jouant de l’acte électoral intéresse les « transitologues » au point qu’ils forgent un néologisme pour le désigner et le distinguer des autres dictatures car il est fondamental pour eux de délimiter clairement la frontière qui sépare la dictature de la démocratie : comment sinon, pouvoir déterminer la fin d’une « transition à la démocratie », c’est-à-dire la réalisation du passage d’une dictature à une démocratie ?
- Distinguer dictature et démocratie
Le fondement plus ou moins revendiqué (selon les auteurs) du concept « transition à la démocratie » consiste dans la (re)valorisation de la démocratie politique et de la liberté de l’électeur comme critère discriminant entre dictature et démocratie. Les « transitologues » (auto-dénomination humoristique des théoriciens des transitions) s’accordent ainsi grosso modo sur la conception procedurale de la démocratie politique dont Robert Dahl a précisé les critères. Pour Dahl, « un régime politique [est] caractérisé par des élections libres et ouvertes, avec des barrières relativement bases pour la participation, une compétition politique véritable et une sérieuse protection des libertés civiles » (résumé de la conception de Robert Dahl dans son ouvrage Polyarchy donné par HIGLEY, John et GUNTHER, Richard, Elites and Democratic Consolidation in Latin America and South Europe, p. 1, Ed. Cambridge University Presse, 1992).
Une telle définition des éléments sur la base desquels on peut commencer à parler de démocratie ne préjuge pas a priori des choix politiques qui seront faits ensuite ni d’une définition plus complète de la démocratie pleine et entière. Considérer qu’une démocratie politique minimale est nécessaire pour commencer à parler de démocratie ne signifie pas forcément qu’on limite la définition de la démocratie à ces procédures indispensables. Aux débuts des travaux sur les transitions à la démocratie en tous les cas, toutes les options restent ouvertes en effet et différentes positions théorico-politiques se retrouvent sur cet accord : aucune démocratie digne de ce nom ne peut faire l’impasse sur une démocratie politique minimale. L’acquis fondamental de la période des transitions consiste à considérer que si les formes de système politique peuvent être très variées, le noyau dur du caractère démocratique d’un régime politique demeure la tenue d’élections libres. L’élection libre est à la fois le symbole de la démocratie (principe du libre choix) et l’instrument technique de sa mise en œuvre.
Il faut alors éclairer les enjeux philosophico-politiques qui animent les disputes autour des termes employés, des dates et des moments privilégiés pour l’analyse. La définition de la transition distingue globalement les régimes démocratiques des régimes autoritaires : des démocraties plus ou moins approfondies face à des dictatures plus ou moins dures. Une transition réalise le saut qualitatif décisif entre les deux termes de l’alternative : si transition il y a, une sortie de dictature se produit, sinon, on peut parler de transition non aboutie ou pseudo transition, lorsqu’on constate une régression à l’intérieur de la forme autoritaire dont on ne serait en quelque sorte jamais sortis. Considérer en revanche que la transition n’est pas terminée après les premières élections libres, ou qu’elle se révèle finalement « introuvable », peut signifier en effet qu’il faut pousser les réformes au de-là de la démocratie minimale posée par la transition. Mais cela peut aussi constituer une critique directe à l’égard de ceux qui ont conduit cette transition en acceptant de fait un cadre imposé par la dictature : accusés alors d’avoir été complaisants voire complices de la dictature.
Refuser d’entendre que le terme de transition est réservé au moment de la sortie pacifique de la dictature qui s’achève par la tenue d’élections libres, c’est en somme refuser de considérer la démocratie politique et le libéralisme politique comme l’opposé radical de la dictature et de l’autoritarisme. La théorie des transitions considère en effet que le libéralisme politique fondé sur la démocratie électorale représentative est une condition sine qua non de la démocratie, elle conçoit une différence de nature radicale entre dictature et démocratie quelles que soient les natures respectives de la dictature et de la démocratie en question dans des cas spécifiques. Tout régime aussi peu répressif soit-il et/ou aussi redistributeur et social soit il sera caractérisé comme une dictature s’il ne satisfait pas aux exigences minimales des libertés politiques individuelles et collectives. Tout régime sera reconnu comme démocratique lorsqu’il fonctionnera sur la base de l’élection libre et transparente et partant du principe de libre choix du gouvernant par le gouverné, aussi insatisfaisant pourra-t-il se révéler aux yeux des uns ou des autres eu égard à d’autres considérations.
- « régime hybride » et « démocratie illibérale »
Cette notion de « défaut » de la démocratie permet en fait bien des complaisances et des compromissions : ces régimes seraient des démocraties dont il suffirait de corriger les défauts, sans doute avec le temps, et avec qui il n’est donc pas immoral de traiter. Un flou est ainsi entretenu –sciemment ou naïvement- quant à la nature du régime à légitimer. Il en sera de même de l’usage de la notion de « régime hybride » laissant entendre qu’il serait impossible de statuer sur la nature démocratique OU autoritaire du régime en question, du fait qu’il mêle des éléments de chacun des types de régimes. Pourtant, comme le souligne clairement Larry Diamond dans son article au titre complet explicite, « Elections Without Democracy. Thinking about Hybrid regimes » (Journal of Democracy, Volume 13, Number 2, April 2002, pp. 21-35), la plupart des régimes qui mêlent élections et autoritarisme ne sont pas des démocraties mais des régimes autoritaires masqués. Larry Diamond préfère le terme « pseudo-démocratie » à celui de démocrature, mais l’idée est la même.
L’aspect « hybride » des démocratures n’est en fait qu’un leurre : la tenue d’élections non libres (pas de liberté de candidature, pas de liberté de presse, pas de liberté d’expression de l’opposition, achat de votes, pressions et menaces sur les électeurs, trucages éventuels des résultats, répression des élus d’opposition, etc…) n’est qu’une apparence de démocratie et non pas un élément partiel de démocratie. « Démocratie illibérale » est d’ailleurs un oxymore, n’en déplaise au promoteur principal de ce terme, Fareed Zakaria (« The Rise of Illiberal Democracy », Foreign Affairs, novembre/décembre 1997) et à ses suiveurs.
Certes historiquement, les notions de démocratie et libéralisme sont disjointes. « La démocratie des Anciens » est née en Grèce au 5ème siècle av. J.C. , époque où la notion de « libéralisme » n’avait pas cours. Tandis que le libéralisme polymorphe qui se formulera aux 17ème et 18ème siècle en Angleterre et en France à partir d’une pensée libérale et d’une philosophie libertine donnera naissance à « la démocratie des Modernes ». Il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui un régime démocratique fonctionne obligatoirement sur la base d’élections libres impliquant respect des libertés individuelles et principe de l’Etat de droit (notamment indépendance de la justice et liberté de presse). Comme le dit bien Marc Plattner : libéralisme et démocratie, on ne peut pas avoir l’un sans l’autre (« Liberalism and Democracy: Can't Have One Without the Other », Foreign Affairs, mars-avril 1998 http://www.foreignaffairs.com/articles/53815/marc- fplattner/liberalism-and-democracy-cant-have-one-without-the-other).
- Mesurer la démocratie
C’est précisément parce que la démocratie est une réalité complexe et jamais parfaite (ou « chimiquement pure » pourrait-on dire) que sa qualité peut s’évaluer, se « mesurer » de façon relativement objective. Tout régime (récemment instauré ou plus ancien) est en effet susceptible d’être soumis à une sorte de comptabilité établie à partir de l’évaluation de chacune de ses institutions et procédures politiques. Robert Dahl exprimera lui-même au début des années 2000 (DAHL, Robert, On Democracy. Ed. Yale University Press, New Haven & London, 2000), la nécessité de préciser l’évaluation des critères qu’il posait en terme généraux dans les années 70 (DAHL, Robert, Polyarchy. Participation and Opposition. Ed. Yale University Press, New Haven & London, 1977).
C’est dans cet esprit que Gerardo Luis Munck dans son ouvrage-manuel Measuring Democracy (Ed. The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2009), propose un système de notation de 1 à 10, appliqué à chacun des critères retenus par Robert Dahl : qualité de la liberté d’expression, niveau d’indépendance du système judiciaire par rapport à l’exécutif, réalité de la liberté de candidater (pas de candidat de l’opposition écarté sur des prétextes fallacieux) et de voter (vote secret, non contrôlé, sans pression), garanties de la fiabilité du scrutin et du rendu des résultats (accès aux bureaux de vote et au décompte des voix pour l’opposition)… Les résultats additionnés donnent une note globale : entre 5 et 10, on est face à une démocratie plus ou moins satisfaisante, en danger ou en progrès ; entre 4 et 0, est en place un autoritarisme plus ou moins dur. Mais ces mesures relativement objectives n’ont que peu de rapport avec les évaluations politiques et géopolitiques.
Des gouvernements qui sont parvenus à s’approprier le contrôle des élections et des institutions qui en garantissent la liberté (presse, appareil judiciaire), et à étouffer les expressions dissidentes des partis politiques et de la société civile par la corruption et la répression, peuvent en effet se payer le luxe de tenir des élections qui leur donneront de larges victoires et les feront passer pour des démocrates aux yeux d’observateurs crédules ou complaisants. Certains y sont parvenus durablement (Venezuela chaviste ou Russie poutinienne), d’autres y travaillent, comme Daniel Ortega au Nicaragua ou Victor Orban en Hongrie, mais dans ce dernier cas, les pressions de l’Union Européenne conjuguées à la mobilisation politique de l’opposition nationale tendent à y faire barrage malgré les graves atteintes à la liberté de la presse et des partis.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan quant à lui, s’il suscite bien la réprobation occidentale pour sa dimension répressive, échange une fiction démocratique contre sa participation supposée à la rétention des réfugiés en-deçà des frontières européennes. De même, le général Al Sissi élu en 2017 et réélu en 2018 avec près de 97% des votes (et une participation de moins de 50%), apparait aux yeux des Occidentaux comme un rempart contre les Frères musulmans, alors qu’il réprime également toute opposition laïque et démocratique et favorise le salafisme. Ces régimes n’en sont pas moins des dictatures avérées ou en voie de consolidation bien que masquées, autrement dit, des démocratures.
Auteur : Renée FREGOSI, philosophe et politologue
Mots-clés : Dictature, démocratie, institutions, libéralisme [1] Ce que l’on a appelé le consensus de Washington consiste dans les prescriptions du FMI et de la Banque Mondiale élaborées en un corpus standardisé et imposée à partir de 1990 aux pays latino-américains pour sortir de la crise de la dette : réduction drastique des dépenses de l’État, privatisations, libéralisation des échanges et dérégulation. À la fin des années 90, des éléments de gestion démocratique, de consultation, de transparence et de contrôle y ont été adjoints pour former les préceptes dits de la « bonne gouvernance » ou « gouvernance démocratique ».